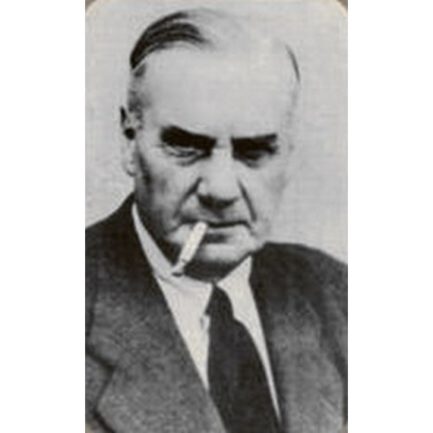
Pierre Souvtchinsky
Pierre Souvtchinsky, né en 1892 dans une famille noble russe, commence par étudier le piano et le chant avant de se tourner vers une carrière intellectuelle. Il rencontre des figures majeures comme Prokofiev, Meyerhold et Diaghilev, et fonde des revues musicales novatrices. Passionné par les courants intellectuels de son époque, il participe à la création du mouvement eurasien, visant à redéfinir la Russie comme un sixième continent entre l’Europe et l’Asie, et s’engage dans des projets politiques et culturels. Après son exil, il s’installe à Berlin, puis à Paris, où il poursuit son action pour l’Eurasie et crée des revues littéraires. Il se recentre ensuite sur la musique et devient un défenseur actif de la musique contemporaine, notamment celle de Boulez, avec qui il entretient une amitié durable. Il continue de travailler jusqu’à sa mort en 1985, influençant la scène musicale et intellectuelle de son époque.
Présentation
Né en 1892 dans une riche famille de la noblesse russe, Pierre Souvtchinsky étudie le piano avec Felix Blumenfeld tout en visant une carrière de ténor d’opéra ; mais se tourne rapidement vers une activité intellectuelle. Blumenfeld l’introduit dans le milieu de la revue « Le Monde de l’art » où il fait connaissance de Meyerhold et Diaghilev. En 1913, il rencontre Prokofiev, qui lui dédiera sa Sonate pour piano n° 5 et sa Symphonie classique ; une année plus tard, Alexander Blok. En 1915, il fonde avec Nikolaï Rimski-Korsakov une revue dédiée aux courants musicaux novateurs, « Le Contemporain musical ». Il côtoie Marina Tsvetaieva, qu’il retrouvera plus tard à Paris, et Anna Akhmatova, suggérant à Prokofiev de composer un cycle vocal sur ses poèmes. En conflit avec Rimski-Korsakov, il abandonne la revue et en crée une nouvelle avec Boris Asafiev, « Melos », dans laquelle la musique est reliée à la poésie et à la philosophie (il voulait l’appeler initialement « L’idée musicale »). Parallèlement, Souvtchinsky adapte Le Joueur de Dostoïevski pour un projet d’opéra avec Nikolaï Miaskovski qui sera abandonné au moment de la Révolution de 1917.
Engagé dans le processus révolutionnaire, il s’occupe de l’Opéra et procède à une restructuration du Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Mais ses origines le rendent suspect. D’abord envoyé à Kiev comme délégué, il est contraint à l’exil et se retrouve à Sofia où il fonde avec le linguiste Nikolaï Troubetskoï et l’économiste et géographe Petr Savitzki le mouvement eurasien, pour lequel est créée une maison d’édition en 1919. L’idée de la Russie comme sixième continent entre l’Europe et l’Asie séduit de nombreux intellectuels russes, tels le linguiste Roman Jakobson, l’historien et philosophe Lev Karsavine, l’historien de la pensée russe Georges Florovski. Les Eurasiens défendent l’autonomie des cultures et prennent en compte les apports des peuples touraniens, mongols, iraniens et turcs qui forment la mosaïque culturelle et identitaire russe. Ils en appellent au retour du religieux et à l’importance des domaines artistiques, qu’ils aimeraient associer à la révolution bolchévique afin de lui conférer une dimension spirituelle complétant son action sociale.
Il s’installe à Berlin en 1921, participe à des productions théâtrales, découvre la musique de Varèse et se lie fortement à Stravinsky. Il noue également des liens étroits avec Wilhelm Furtwängler dont il est parfois l’oreille extérieure et avec qui il a de longues discussions. Grâce aux efforts de Prokofiev, il parvient à s’installer à Paris à la mi-mai 1925. Il intensifie son action en faveur de l’idée eurasienne, entouré de nouveaux collaborateurs. Mais certains d’entre eux se révéleront être des agents soviétiques. Souvtchinsky n’en crée pas moins une nouvelle revue, « L’Eurasie », domiciliée chez lui, et devient le secrétaire général d’une revue poétique publiée en langue russe, Versty. Le mouvement eurasien se divise toutefois entre les tenants d’une action politique et ceux qui veulent le limiter à une influence idéologique et spirituelle. Plusieurs membres du mouvement, dont Souvtchinsky, décident de retourner en Russie ; par chance, son visa lui est refusé ; ses associés finiront tous dans les camps.
Dès lors, Souvtchinsky abandonne le projet eurasien et à la fin de l’année 1929 se recentre sur la musique et les arts. C’est à ce moment-là qu’il se lie d’amitié avec Artaud, Michaud et Char notamment, ainsi qu’avec de nombreux musiciens. En 1939, Stravinsky lui demande de travailler avec lui à la préparation des conférences qu’il doit donner à Harvard et qui paraîtront sous le titre de Poétique musicale.
Fasciné par Boulez dès 1946-1947, dont il reconnaît d’emblée le génie, il se lie d’amitié avec lui et contribue fortement à la création du Domaine Musical en 1954. Très actif dans le milieu artistique, homme de l’ombre, il écrit différents essais sur la musique, notamment sur la question du temps, et publie un ouvrage sur la musique russe tout en soutenant Boulez avec lequel il entretiendra une grande complicité jusqu’à sa mort en 1985.

