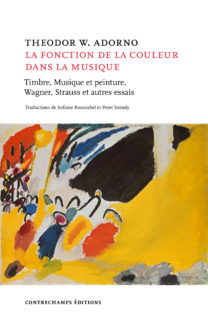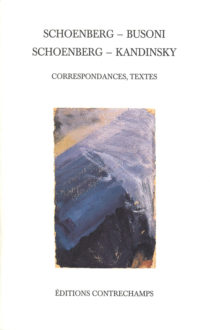Contrepoints
Les convergences entre arts du temps et de l’espace sont plus actuelles que jamais. Rencontres, doubles vocations, collaborations, influences, transpositions, métissages divers caractérisent l’esthétique de notre temps, dont l’ouverture multimédia s’affirme comme un refus du purisme des générations précédentes.
Présentation
Les convergences entre arts du temps et de l’espace sont plus actuelles que jamais. Rencontres, doubles vocations, collaborations, influences, transpositions, métissages divers caractérisent l’esthétique de notre temps, dont l’ouverture multimédia s’affirme comme un refus du purisme des générations précédentes. Mais le phénomène ne date pas d’hier, et la modernité se teinte parfois d’archaïsme. C’est Stendhal qui nous a légué la manie des comparaisons entre peintres et compositeurs, et les permanences sont nombreuses et significatives, qui vont des origines pythagoriciennes de la musique des sphères aux racines romantiques du musicalisme. Cette quête de correspondances, expression d’une nostalgie de l’unité perdue, s’oriente tantôt vers le domaine des synesthésies et du mythe de l’audition colorée, tantôt vers celui des proportions harmoniques, où l’analogie musicale s’insinue dans les théories picturales. La peinture elle-même n’y échappe guère, et Bach et Wagner sont sans doute les musiciens qui ont le plus souvent nourri l’imaginaire des artistes. C’est à diverses facettes de ce dialogue séculaire que sont consacrés ces essais.
Auteurs

Philippe Junod
Parallèlement à des études de lettres classiques et d’histoire de l’art achevées en 1961 à Lausanne, Philippe Junod étudie le piano et la musicologie avec Jacques Chailley et Nadia Boulanger à Paris, puis l’archéologie orientale. Il est membre de l’Institut suisse de Rome de 1965 à 1967. Il obtiendra son doctorat à la Faculté des Lettres de Lausanne en 1976 avec une thèse intitulée Transparence et opacité (elle sera publiée par L’Âge d’homme en 1967 et rééditée chez J. Chambon en 2004). C’est en 1971 qu’il débute son activité à l’Université de Lausanne où il sera professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain jusqu’à sa retraite en 2003.