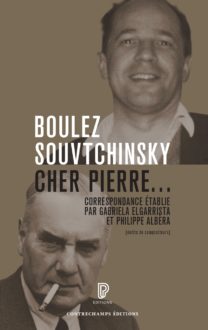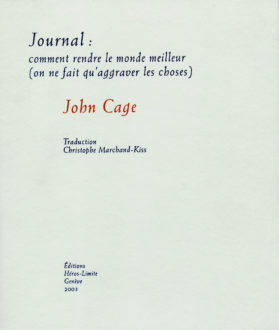Henri Pousseur
Henri Pousseur (1929-2009) est un compositeur belge formé au Conservatoire de Liège. Influencé par Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen, il se spécialise dans la musique postwébernienne et électroacoustique. Ses œuvres explorent l’idée de l’œuvre ouverte, notamment avec Votre Faust, un opéra interactif. Il cherche à intégrer des éléments musicaux variés, allant de la musique classique à la musique populaire, comme dans Couleurs croisées (1967). Enseignant et pédagogue, il fonde le Centre de recherches musicales en Wallonie et se consacre à la réforme de l’enseignement musical. Dans ses dernières années, il explore les relations entre musique, images et textes.
Présentation
Henri Pousseur (1929-2009) a fait ses études au Conservatoire de Liège de 1947 à 1952. Il eut comme professeurs Pierre Froidebise et André Souris. Ses rencontres avec Pierre Boulez en 1951 et Karlheinz Stockhausen deux ans plus tard sont décisives : il s’inscrit dans le courant postwébernien défendu par le premier et travaille, grâce au second au Studio électro-acoustique de Cologne. Il participe à partir de 1954 aux cours d’été de Darmstadt. Pousseur accompagne ses œuvres (les Trois chants sacrés, Symphonies à 15 solistes, Quintette à la mémoire de Webern) de réflexions théoriques, développant des idées originales notamment sur la musique de Webern.
Dans un deuxième temps, à partir de 1956, il va explorer les potentialités de l’œuvre ouverte, dans des œuvres telles que Mobile et Répons. Elles le conduisent au grand projet de Votre Faust, « fantaisie variable, genre opéra », conçu avec l’écrivain Michel Butor : les spectateurs sont appelés à choisir entre différentes formes de continuité. Cette œuvre élaborée tout au long des années 1960 et finalement créée à Milan en 1969 génère toute une série d’œuvres satellites, qui peuvent être jouées de façon indépendante.
Parallèlement, il poursuit sa réflexion entamée à partir de l’œuvre de Webern sur la question harmonique, cherchant à établir des réseaux multipolaires qui seraient à même d’intégrer différentes sortes de musique. Dans Couleurs croisées pour orchestre (1967), il mélange des styles hétérogènes sur la base matricielle d’un chant noir américain, « We shall overcome », réintégrant le diatonisme dans le concept de série, et faisant référence aussi bien à Monteverdi qu’à la musique expressionniste. Il consigne ses idées dans un grand esse intitulé « L’Apothéose de Rameau » (1968). Dès lors, sa musique comprendra souvent des emprunts aux musiques du passé.
Enseignant à l’université de Buffalo (1966-1968), fondateur du Centre de recherches musicales en Wallonie en 1970 avec Pierre Bartholomée et Philippe Boesmans, il poursuit sa démarche intégrative en collaboration avec Michel Butor et compose un hommage à Schönberg : Die Erprobung des Petrus Hebraïcus, qui prend le titre, dans sa version française, de Procès du jeune Chien. Il devient en 1975 directeur du Conservatoire de Liège et se préoccupe dès lors de pédagogie (projets de réforme de l’enseignement, œuvres pédagogiques, comme Méthodicare). De 1984 à 1987, il dirige l’Institut de pédagogie musicale à Paris. Il explore en sa dernière période les relations multimédiales, qui associent musique électroacoustique et images numériques, mais aussi des textes de Michel Butor, comme dans Voix planétaires, en 2003-2004, qu’il définit par le terme d’« ethno-électroacoustique ».